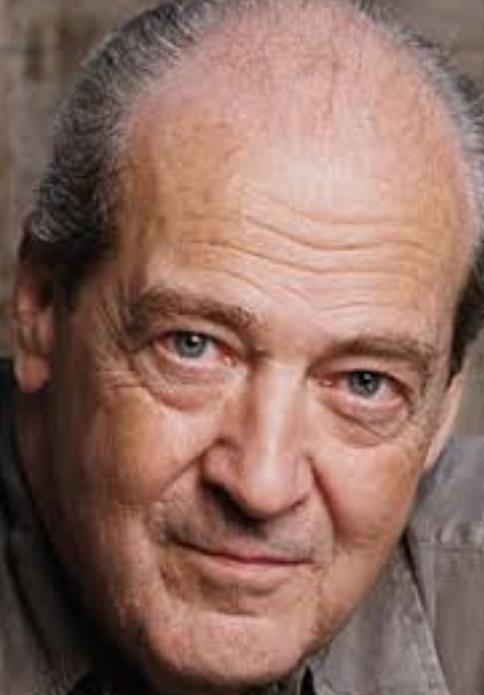 Qui n’a pas entendu parler de l’effroyable génocide perpétré par ceux que nous appelons les « Khmers rouges » au Cambodge, entre 1975 et 1979 ? Sous la supervision de Pol Pot, 20% de la population du pays, soit 1,7 millions de personnes auraient trouvé la mort, selon les hypothèses les plus avancées (1). Victimes de la mise en place d’un régime totalitaire et extrémiste, dont les mesures, confinant à l’absurdité, finissent par annihiler la population. Si la majorité des décès est due à la famine (mon guide au Cambodge me racontait que le rendement agricole n’avait jamais été si haut, puisque les Khmers rouges avaient vidé les villes et déplacé la population à la campagne, mais que les récoltes étaient vendues à l’extérieur du pays), cette mise à mort méthodique s’accompagne de pratiques particulièrement cruelles, que je ne décrirai pas ici… Je vous invite à voir le magnifique et éprouvant documentaire de Rithy Panh, « S21, la machine de mort khmère » (2000), pour en savoir davantage. Sûrement inspirée par la « Révolution culturelle » chinoise, lancée par Mao en 1966, qui elle aussi a été particulièrement meurtrière, le processus s’avère encore plus radical.
Qui n’a pas entendu parler de l’effroyable génocide perpétré par ceux que nous appelons les « Khmers rouges » au Cambodge, entre 1975 et 1979 ? Sous la supervision de Pol Pot, 20% de la population du pays, soit 1,7 millions de personnes auraient trouvé la mort, selon les hypothèses les plus avancées (1). Victimes de la mise en place d’un régime totalitaire et extrémiste, dont les mesures, confinant à l’absurdité, finissent par annihiler la population. Si la majorité des décès est due à la famine (mon guide au Cambodge me racontait que le rendement agricole n’avait jamais été si haut, puisque les Khmers rouges avaient vidé les villes et déplacé la population à la campagne, mais que les récoltes étaient vendues à l’extérieur du pays), cette mise à mort méthodique s’accompagne de pratiques particulièrement cruelles, que je ne décrirai pas ici… Je vous invite à voir le magnifique et éprouvant documentaire de Rithy Panh, « S21, la machine de mort khmère » (2000), pour en savoir davantage. Sûrement inspirée par la « Révolution culturelle » chinoise, lancée par Mao en 1966, qui elle aussi a été particulièrement meurtrière, le processus s’avère encore plus radical.
Issus du Protectorat français sur l’Indochine et se nourrissant des troubles et décombres de l’interminable guerre qui a ravagé le pays voisin, le Vietnam, entre 1946 et 1975 (2), le mouvement des Khmers rouges apparaît sous l’égide de ce dernier pays qui se convertit peu à peu au Communisme ; sa formation est pilotée par le Viêtmin, organisation paramilitaire créée par le Parti Communiste Vietnamien. En 1953, le Cambodge devient indépendant, sous la direction du roi Norodom Sihanouk et les Khmers rouges entrent dans l’opposition jusqu’en 1968, où ils provoquent un coup d’état ; s’ensuit une période de trouble avec une mainmise de plus en plus forte de la part des Vietnamiens, qui conduit à la déchéance du roi en 1970 et à l’installation d’une « République khmère » en conflit avec les Khmers rouges jusqu’à ce que ces derniers prennent le pouvoir en 1975.
Le récit de François Bizot se situe pendant cette période difficile. Anthropologue français, spécialiste de l’Asie du Sud-Est, il s’installe en 1965 à Siem Reap, près des temples d’Angkor avec sa famille. En octobre 1971, il est arrêté avec deux assistants khmers par les Khmers rouges et emprisonné dans un camp dirigé par Kang Kek Leu, alias Douch, le futur bourreau du camp S21 à Phnom Penh. Ce dernier, né en 1942, issu d’une famille modeste, a réussi à devenir professeur de mathématiques, avant de basculer dans la clandestinité du mouvement et d’en devenir l’une des plus noires égéries.
La première partie du livre nous raconte cet emprisonnement. L’auteur a pour lui deux forces, celle d’être un Européen, exotique dans ce camp de jungle et celle de parler la langue khmère et de comprendre (un peu) la mentalité des gens du pays. Il va donc bénéficier d’un traitement particulier ici (il ressortira vivant du camp au bout de deux mois et demi, à la différence de ses deux assistants). Mais ce régime n’est pas un régime de faveur, l’intéressé fait preuve de courage et de détermination, ne cède pas devant les multiples menaces. Et nous assistons à quelque chose d’improbable, la naissance de relations que nous pourrions presque qualifier d’amicales entre lui et Douch, qui apparaît ici comme un homme simple, très scrupuleux et presque anxieux de remplir ses missions correctement.
L’histoire de cette relation, improbable, est contée par l’auteur avec beaucoup de nuances ; dans ce livre écrit près de trente ans après les faits, il ne se livre pas à la tentation du révisionnisme, qui aurait pu le saisir au vu des horreurs commises par Douch dans les années qui suivent (3) et évite également le piège de la forfanterie. Avec une grande humanité (au sens premier du terme), il raconte comment ces deux hommes à la trajectoire si dissemblable se sont presque touchés ; ce ne peut être de l’amitié, ce n’est pas non plus le syndrome de Stokholm, juste des moments où les deux se respectent et parviennent à communiquer.
Dans la deuxième partie du livre, nous sommes quatre ans plus tard, lorsque les Khmers rouges ont officiellement pris le pouvoir. François Bizot est présent lorsque ces derniers vident la capitale de ses habitants (presque deux millions de personnes…). Hébergé à l’Ambassade de France, comme tant de réfugiés français et autres, il sert d’interprète au chargé d’affaires Jean Dyrac (4), qui essaye de sauver ses ouailles. Conscient de ce qui se passe, de par son expérience antérieure, il va négocier avec l’officier qui est en faction devant l’Ambassade. Pour aller à la recherche de vivres, pour partir sauver quelqu’un, pour éviter certains drames. Car, du fait de sa connaissance de ce qui se déroule dans ce pays, il comprend souvent plus rapidement que bien d’autres les événements. Et il n’est parfois pas écouté, tel une Cassandre moderne, comme par exemple dans l’épisode glaçant où un homme arrive en voiture à l’Ambassade et insiste pour repartir chercher sa femme et sa fille ; François Bizot, profitant de l’absence de l’officier Khmer rouge, obtient de pouvoir partir en jeep militaire ; mais l’homme ne veut rien savoir, s’escrime à essayer de faire redémarrer sa voiture, le temps passe… Et l’officier revient, mettant fin à la tentative. « Il quitta seul le Cambodge et fut rapatrié en France » nous dit l’auteur en point final de cette anecdote.
C’est un récit lucide, d’un témoin particulièrement intéressant, qui nous est livré ici, dans une langue de bonne tenue, sans recherche d’effets, sans doute inappropriés pour un tel livre. François Bizot est sans doute l’un des rares protagonistes occidentaux de ce drame qui en a pris toute la mesure au moment même où il se déroulait. En cela, la lecture de cet opus est indispensable.
Merci à lui.
FB
(1) Programme d’étude de l’Université Yale.
(2) Nous segmentons historiquement le conflit en deux périodes : la Guerre d’Indochine (1946-1954), menée par les Français et qui se termine par le désastre de Dien Bien Phu et la Guerre du Vietnam (1955-1975) menée par les Etats-Unis ; c’est quand même une seule et unique guerre qui ravage le pays pendant presque trente ans…
(3) Dans la prison S-21 (ou Tuol Seng), installée à Phnom Penh, Douch a organisé la torture de plus de 15 000 personnes entre 1975 et 1979.
(4) L’ambassadeur avait été rappelé en France en 1971.

Attention, c’est Jean-François Bizot que vous avez mis en photo et non François Bizot ! 🙂
Merci beaucoup, belle erreur de ma part, j’ai mis à jour mon article.